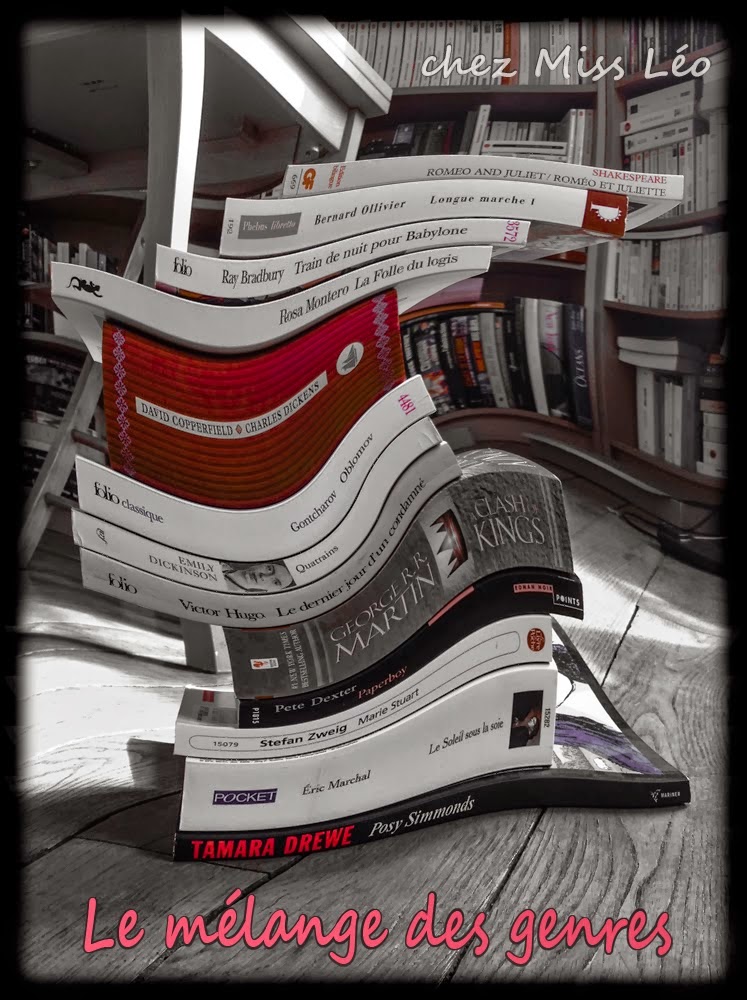|
| Anthony Trollope, Le Dr Thorne (1858) traduction Alain Jumeau Editions Points, 2014, 781 p. |
Dans la vie tout est une question de moment, et je ne pouvais choisir pire que le mois de juin pour m'attaquer au Docteur Thorne de Trollope, un joyeux pavé de 780 pages consacrées aux circonvolutions du mariage contrarié à l'époque victorienne.
Je m'étais donnée 3 semaines, il m'en a fallu le double, et encore... y serais-je parvenue sans une semaine de repos forcé ? Rien n'est moins sûr.
C'est ainsi que j'ai suivi les aventures de la douce Mary Thorne, à la fois déterminée et tolérante, amoureuse et généreuse, loyale et sincère (avec un prénom pareil, peut-elle vraiment être autrement?). Cette pauvre Mary donc, sans naissance ni fortune, est la nièce du Dr Thorne, mais surtout l'amoureuse de Franck Gresham, l'héritier désargenté du domaine de Greshamsbury, qui doit nécessairement "épouser une fortune" pour sauver la propriété hypothéquée de son père ruiné.
Typiquement dans la lignée de littérature victorienne, chez le Dr Thorne, on trouve des roturiers en mal de reconnaissance, des aristocrates imbus d'eux-mêmes, des parvenus anoblis qui ne se sentent pas à leur place, des amours contrariés. Evidemment, c'est long, Trollope aurait pu faire plus court, plus concis, il aurait pu largement alléger son roman de quelques centaines de pages. Bien sûr, toutes ces réflexions autour du mariage, sur ce qu'il apporte, et ce qu'il implique peuvent paraître complètement datées en 2015. Sans surprise, on a une happy-end convenue qui arrange les problèmes de tout le monde.
 Et pourtant...malgré les répétions de danse, la chorale de l'école, les auditions du conservatoire, les réunions d'entrée au CP, la perspective d'avoir 9 semaines avec les enfants, la canicule soudaine et perfide, je ne l'ai pas lâché. Certains soirs, alors que je m'endormais au bout de quelques pages, j'arrivais à rester attachée aux personnages, bien que le dénouement ne constituât aucun mystère. Car, au delà des codes convenus, je dois dire qu'on trouve chez Trollope des scènes absolument délicieuses qui n'épargnent en rien le genre humain (dont on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qui ne changent pas à travers les siècles : la cupidité, la lâcheté, la mesquinerie, la vénalité, l'arrogance. A ce titre la scène du dîner chez le duc d'Omnium est vraiment un morceau d'anthologie).
Et pourtant...malgré les répétions de danse, la chorale de l'école, les auditions du conservatoire, les réunions d'entrée au CP, la perspective d'avoir 9 semaines avec les enfants, la canicule soudaine et perfide, je ne l'ai pas lâché. Certains soirs, alors que je m'endormais au bout de quelques pages, j'arrivais à rester attachée aux personnages, bien que le dénouement ne constituât aucun mystère. Car, au delà des codes convenus, je dois dire qu'on trouve chez Trollope des scènes absolument délicieuses qui n'épargnent en rien le genre humain (dont on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qui ne changent pas à travers les siècles : la cupidité, la lâcheté, la mesquinerie, la vénalité, l'arrogance. A ce titre la scène du dîner chez le duc d'Omnium est vraiment un morceau d'anthologie). J'y ai retrouvé aussi ce qui me manque chez Austen: l'irréversible tragique, qu'on retrouve ici concentré chez les Scatcherd. Même s'il s'agit de personnages secondaires, pas tant que cela finalement, puisqu'il s'agit d'un maçon anobli en baronnet, qui ne se remet jamais vraiment d'intégrer la haute société et qui finit littéralement dévoré par l'alcool. D'ailleurs la description de l'alcoolisme chez les Scatcherd n'aurait presque rien à envier à Zola, tant c'est juste et poignant. Plus encore, les réflexions sur la famille Scatcherd sont d'une modernité assez géniale: "Si l'on souhaite trouver dans le monde des prénoms royaux (...) il faut orienter les recherches en direction des familles de démocrates. Personne n'a la même déférence servile jusque pour les rognures d'ongle de la royauté" (p.182). Il est de ces paradoxes qui ne changent pas avec le temps.
J'y ai retrouvé aussi ce qui me manque chez Austen: l'irréversible tragique, qu'on retrouve ici concentré chez les Scatcherd. Même s'il s'agit de personnages secondaires, pas tant que cela finalement, puisqu'il s'agit d'un maçon anobli en baronnet, qui ne se remet jamais vraiment d'intégrer la haute société et qui finit littéralement dévoré par l'alcool. D'ailleurs la description de l'alcoolisme chez les Scatcherd n'aurait presque rien à envier à Zola, tant c'est juste et poignant. Plus encore, les réflexions sur la famille Scatcherd sont d'une modernité assez géniale: "Si l'on souhaite trouver dans le monde des prénoms royaux (...) il faut orienter les recherches en direction des familles de démocrates. Personne n'a la même déférence servile jusque pour les rognures d'ongle de la royauté" (p.182). Il est de ces paradoxes qui ne changent pas avec le temps.
Plus important encore, Trollope nous parle du "squire" (père ruiné de Franck), ce titre de l'entre deux classes, entre la noblesse et la roture, mais dont toute l'histoire tourne autour de sa ruine. Il est finalement question essentiellement d'argent dans ce roman, qui il y a 150 ans comme maintenant, dirige le monde, fonde et défait les réputations, inspire le respect ou le mépris, fait basculer une élection dans un sens ou dans l'autre : "Il y a peu d'endroits où un homme riche ne peut se payer des camarades" (p.394) . Un constat finalement amer quand on referme ce livre, car au delà de la fin joyeuse, il est la clef de résolution de l'intrigue, et c'est finalement assez déprimant.
 Au final, ce que réussit le mieux Trollope, c'est ce qu'il invente autour du médecin irréprochable et de notre couple d'amoureux. Tous les trois restent définitivement beaucoup moins intéressants que Miss Dunstable (roturière excentrique sans beauté mais richissime, entre deux âges, courtisée de toutes parts par des prétendants cupides), Lady Arabella (mère de Franck, aristocrate amère parce que pauvre, sans doute très malade, hypocrite et vénale et qui tente de sauver le reste de prestige du domaine qu'elle habite), le père de Franck (dépressif, adorant son fils, accablé par les dettes, tiède et sans volonté réelle), Sir Louis, fils dépravé du baronnet Scatcherd, l'arrogant Dr Fillgrave ou bien le furtif Mr Moffat absolument délicieux dans son genre : "Il avait passé sa vie à calculer comment tirer le maximum de lui-même. Il ne s'était laissé aller à commettre aucune folie par suite des inadvertances de son coeur: aucune erreur de jeunesse n'avait gâché ses chances dans la vie. Il avait tiré le meilleur parti de lui-même" (p.307)
Au final, ce que réussit le mieux Trollope, c'est ce qu'il invente autour du médecin irréprochable et de notre couple d'amoureux. Tous les trois restent définitivement beaucoup moins intéressants que Miss Dunstable (roturière excentrique sans beauté mais richissime, entre deux âges, courtisée de toutes parts par des prétendants cupides), Lady Arabella (mère de Franck, aristocrate amère parce que pauvre, sans doute très malade, hypocrite et vénale et qui tente de sauver le reste de prestige du domaine qu'elle habite), le père de Franck (dépressif, adorant son fils, accablé par les dettes, tiède et sans volonté réelle), Sir Louis, fils dépravé du baronnet Scatcherd, l'arrogant Dr Fillgrave ou bien le furtif Mr Moffat absolument délicieux dans son genre : "Il avait passé sa vie à calculer comment tirer le maximum de lui-même. Il ne s'était laissé aller à commettre aucune folie par suite des inadvertances de son coeur: aucune erreur de jeunesse n'avait gâché ses chances dans la vie. Il avait tiré le meilleur parti de lui-même" (p.307)
Avec cette galerie de personnages, Jullian Fellowes, (oui, oui celui de Downton Abbey) devrait pouvoir faire une adaptation tout à fait réjouissante, ne serait-ce qu'en reconstituant la famille de Courcy (une caricature de l'aristocratie anglaise du XIXe siècle).
Je remercie le fournisseur officiel de ce billet: Notre Titine nationale qui me l'a fait gagner l'an dernier dans un concours qu'elle a organisé sur son blog grâce aux Editions Points. Une Titine au top de sa britannitude puisqu'elle a rallongé son mois anglais en A Year in England dont ce billet est ma première participation.
C'est également ma participation au challenge de Brize pour le pavé de l'été, et là pardon mais avec 760 pages je pense m'en vanter encore quelques temps ;-) (oui, je ne suis que vanité)